Quand la nature et l'humanité se rencontrent, il en sort un roman étrange et puissant, grondant et poétique, profondément ancré dans des paysages sauvages et préservés, sublimés par la plume d'un écrivain au plus près des émotions et des mots.
Avec "Quartiers libres », un recueil collectif de nouvelles explorant la question de la ville et des marges, les éditions La Volte poursuivent leurs explorations à la fois textuelles et politiques. Ici, il est question de passer les espaces urbains et la question de la vie en société au prisme de la SF et de l’anticipation. Il est question d’IA, d’épuisement des ressources et des matériaux, de violences urbaines, de ghettoïsation, mais aussi, quand même, d’invitation à imaginer un futur plus égalitaire, plus apaisé. "Quartiers libres" se vit comme une cartographie mouvante : chaque contribution déplace les frontières entre centre et périphérie, utopie et réel, intime et commun. Trois des quinze plumes rassemblées ici pour mettre en mots les craintes et aspirations liées à la ville de demain, Li-Cam, Ketty Steward et Elodie Doussy, livrent leur vision du collectif, leur rapport à la nouvelle, et leur vision politique de l’imaginaire.
Comment avez-vous rejoint ce recueil collectif autour de la thématique de la ville du futur ?
Elodie Doussy : J’ai rejoint le recueil Quartiers Libres par ma participation à un appel à texte lancé par La Volte fin 2023. Il faut savoir que quand j’ai vu l’appel à texte, je me suis dit « c’est pour moi ! », parce que La Volte, c’est une maison d’édition que j’aime bien, pour sa ligne éditoriale notamment, mais aussi parce que la thématique de la ville m’est très chère, sachant que je travaille dans le domaine de l’urbanisme. J’ai failli ne pas participer, parce que j’étais trop en retard dans l’écriture, mais au final la deadline de l’appel à texte a été décalée d’un mois, et j’ai pu envoyer ma nouvelle le dernier jour à 23h25, donc vraiment in extremis !

Ketty Steward : J’ai participé aux trois précédents recueils de La Volte ( Sauve qui peut – Demain la santé, Au Bal des Actifs – Demain le travail, Faites demi-tour dès que possible) et c’est par jeu que j’ai eu envie de proposer quelque chose pour cet appel à texte sur la ville. Pourquoi arrêter la série ? Je me suis donc interrogée sur ce que j’avais envie d’explorer en lien avec le thème et c’est la question des déplacements en ville qui m’a semblé une bonne entrée.
Li-Cam : J’ai répondu à l’appel à textes de La Volte. Puis j’ai attendu le verdict du comité de lecture qui s’est avéré favorable pour mon plus grand plaisir.
Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de cette nouvelle ? Comment avez-vous construit ce micro-univers ?
E.D : Ce qui a motivé l’écriture de cette nouvelle est avant tout mon attrait pour les villes. J’ai beaucoup à dire sur ce sujet, étant donné que c’est ce sur quoi je travaille chaque jour. J’ai pris comme point de départ des problématiques actuelles dans les villes, à savoir la nature, la culture, mais aussi la concertation urbaine, qui est le fait de consulter la population dans le cadre de la réalisation d’un projet urbain. J’ai aussi travaillé sur les risques en ville, plus particulièrement ceux entrainés par le réchauffement climatique. En m’aidant de lectures telles que Le champignon de la fin du monde d’Anna Tsing, j’ai requestionné ces thématiques : Que veut-dire la nature en ville ? Qu’est-ce que la nature, d’ailleurs ? Doit-on l’accepter même quand elle représente un danger pour nous ? Que ce passe-t-il, quand la toute-puissance du progrès technique s’estompe ? J’ai voulu parler de ce qu’il reste quand les Babel modernes, ultra-technologiques, ultra-minérales et ultra-libérales s’effondrent : la vie ne s’arrête pas. Nous vivons dans les ruines, au milieu des éboulements et des végétaux qui ont su renaitre de rien. Dans cette nouvelle, j’ai donc voulu opposer un imaginaire du progrès à un imaginaire du « primitif », représenté par une danse de la pluie. En plus, j’adore la danse, j’adore danser, ce qui en fait un de mes sujets d’écriture de prédilection, avec les villes !

K.S : Comme souvent, je suis partie d’une idée un peu légère et de questionnements plus existentiels. L’idée était ce GPS intégré au système nerveux, sans écran et sans voix. Une technologie qui ne passerait pas par les sens les plus couramment sollicités : la vue et l’ouïe. Qu’est-ce que ça serait de l’utiliser, ou de cesser de l’utiliser ? La question plus profonde est l’utilisation courante de la métaphore du chemin dans la vie de tous les jours, notamment en thérapie où, me semble-t-il, elle n’est pas très efficace pour aider à aller mieux. On écrit des fragments, on secoue, on les colle et ça donne mon texte. Ce n’est pas un micro-univers, mais une petite fenêtre sur un univers bien plus vaste qu’on aperçoit en arrière plan. C’est ça que permettent les nouvelles.
L.C : La ville est un sujet qui m’intéresse beaucoup, l’adaptation de la ville au dérèglement climatique tout particulièrement. Je l’avais déjà abordé dans mon roman, Visite, paru à La Volte en 2023 et j’avais fait alors beaucoup de recherches. Une saison sous Terre se déroule dans l’univers de Visite, mais cette fois, durant la saison chaude. Les deux textes décrivent une société qui a bifurqué et dans laquelle la préservation du Vivant est centrale.
Que craignez-vous le plus de voir se réaliser dans un futur proche, celui que nous risquons de connaître ?
E.D : J’ai peur que pour toujours, l’économie continue à primer sur le social. Que pour toujours, pour l’enrichissement infini de quelques-uns, on continue à vivre dans un système qui épuise les ressources et fabrique des inégalités. L’économie n’est pas une fin en soi. Elle devrait servir le social, et non l’inverse. Pourtant, on continue dans ce système qui voudrait une croissance infinie et qui transforme, de ce fait, la terre en désert.
K.S : Le plus ? Je ne sais pas. Je pense avoir eu plus que ma part de ce qui peut mal aller dans une vie, aussi, ne suis-je pas dans la peur pour ce qui me concerne. Je suis désespérément optimiste. Sur le plan collectif, la France, l’Occident, le monde ont montré et montrent tous les jours leur capacité à nuire à d’autres humains, aux espèces vivantes et à la planète, donc là encore, pas de crainte particulière, hormis, peut-être qu’on arrête tous et toutes d’essayer de mieux faire. Mais je ne crois pas que ça arrivera. Il y a toujours des illuminés qui essaient et c’est tant mieux.

L.C : Le dérèglement climatique m’inquiète beaucoup, il m’inquiète d’autant plus que j’ai l’impression que nous ne prenons pas la mesure de ce qui nous attend. Le réchauffement climatique est le thème principale de Une saison sous terre. Je ne me vois pas écrire de la science-fiction sans aborder le climat, et la nécessité de changer nos modes de vie.
Quelles sont les thématiques qui traversent votre écriture par ailleurs ?
E.D : Les villes, beaucoup. La danse, souvent. Mais surtout les villes. Je trouve qu’elles sont un moyen idéal, ou au moins efficace, d’illustrer des contextes politiques et leurs conséquences sur la vie des gens. Culte du progrès et tendance à la sobriété ne donnent pas les mêmes villes. Je trouve que c’est particulièrement vrai en science-fiction, qui met en scène, à différentes échelles, des rencontres entre des technologies et des personnes. Les villes, à leur manière, sont aussi des histoires de rencontres entre des techniques, du dur, du bâtiment, et des gens, du social, de l’humain. Cette rencontre crée des façons de vivre, des conséquences, des problèmes, des bonheurs ou des douleurs. Et ces rencontres sont le fruit de volontés politique. Les villes sont une sorte de « show don’t tell » des systèmes politiques, en fait !
K.S : J’écris sur les thèmes qui me questionnent. Le temps, le travail, la vérité, l’organisation des sociétés, sont des sujets qui reviennent régulièrement. J’ai récemment écrit une novella sur la nourriture, « Foodistan Après la Faim du monde » et mon prochain ouvrage portera sur l’imposture. C’est assez varié, finalement.
L.C : Je m’intéresse beaucoup à l’IA, à ce qu’elle pourrait apporter et aux dangers qu’elle représente. J’aborde aussi beaucoup la neurodiversité. Ça me parait important de proposer des personnages avec des psychologies divergentes dans un soucis de visibilité et d’invitation à la tolérance. La politique et la géopolitique me préoccupent beaucoup ces derniers temps pour des raisons évidentes. J’aime élaborer des univers complexes qui dépeignent des sociétés différentes de la nôtre en les décrivant sous toutes leurs facettes. À mes yeux, l’univers est aussi important que les personnages et l’intrigue dans l’élaboration d’un récit.
Qu’est-ce qui vous attire dans l’imaginaire ? Et vous plaît dans la nouvelle ?
E.D : L’imaginaire est force de proposition. Des fois, collectivement, on a du mal à s’imaginer comment les choses pourraient changer ou être autrement. Pour faire simple, on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je trouve que l’imaginaire permet d’inverser cette tendance. Mettre en récit, c’est donner vie à des systèmes meilleurs qui peuvent paraitre un peu abstraits. C’est prouver que ces systèmes sont possibles au-delà de la théorie. Pour l’écriture de ma nouvelle, j’avais bien en tête Eutopia, de Camille Leboulanger, lu quelques mois plus tôt. L’auteur a construit son univers à partir des travaux de Bernard Friot, un sociologue qui travaille sur le salaire à vie. Tout de suite, on comprend comment ce système pourrait tenir, sans avoir à se plonger dans des ouvrages scientifiques parfois un peu complexes à appréhender. Concernant la nouvelle, j’en écris beaucoup. Je trouve que l’avantage des format court, c’est de pouvoir présenter des concepts, des univers complets mais de manière condensée, et d’y aller à fond sur le style sans ne jamais s’essouffler ou essouffler le lecteur. La nouvelle c’est un shot, là où le roman, court ou long, est un cocktail !
K.S : J’écris dans d’autres registres, mais les genres de l’Imaginaire et en particulier la science-fiction me permettent de mettre en forme mes questions sur le monde tel qu’on nous le raconte et de tenter d’autres lectures. C’est l’aspect spéculatif et expérimental de ces genres qui me convient. Quant à la nouvelle, c’est le format dans lequel je me sens le plus à l’aise pour creuser, parfois un unique aspect d’une question précise, sans diluer, sans s’égarer, quitte à rassembler, plus tard, des textes sur le même thème en recueils, comme j’ai pu le faire avec « Saletés d’hormones et autres complications ». Le défi avec le très court est de conserver la complexité dans un espace limité et je trouve ça stimulant. Je tente des façons de faire, du collage polytextuel, des mises en écho de voix différentes, etc. C’est un très bel endroit d’expérimentation que le carrefour où les genres de l’imaginaire et le format court se rencontrent.
L.C : La science-fiction et l’anticipation, particulièrement, permettent de faire des expériences de penser. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir, mais de tirer des fils et d’explorer des possibles. L’imaginaire permet une liberté plus grande. Je le trouve aussi plus agréable à lire et à écrire, il recèle une part de merveilleux et d’étrangeté qui me plait énormément. Je suis plutôt une marathonienne, j’écris plus volontiers des fictions longues. Mais j’aime beaucoup les nouvelles. Je les envisage comme des petits laboratoires qui me donnent l’occasion de tester des choses. Et j’en écris de plus en plus.
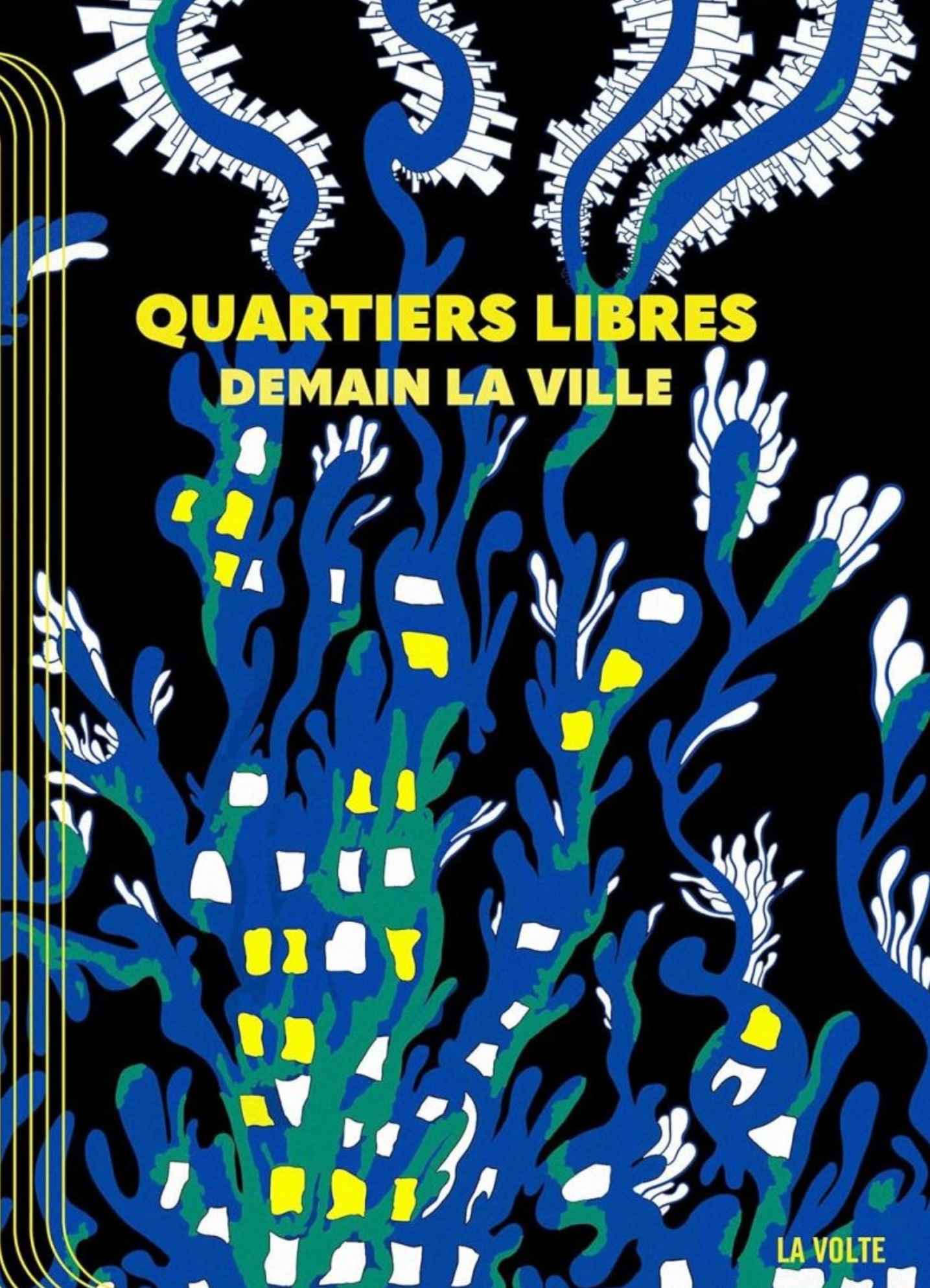
![[INTERVIEW] Ketty Steward, Li-Cam et Elodie Doussy pour l'anthologie "Quartiers libres"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/68ff4f1c0d886c902d4a0e33_quartiers-libres-la-volte-interview.jpg)
![[INTERVIEW] Pierre Chavagné : "La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6938013865c7fbebfa2c0654_abena-pierre-chavagne-lemotetlereste.jpg)
![[INTERVIEW] Laura Lutard : " Soudain, le poème est impératif !"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6932f7ad65a3c836e0d2d5dd_laura-lutard-nee-tissee.jpg)
