Avec ce nouveau recueil, paru chez les excellentes éditions Bruno Doucey, Laura Lutard poursuit son exploration de l’identité, des racines et des secrets familiaux. Avec pudeur, humour, justesse, à l’image de ses réponses.
Nature writing et inquiétude contemporaine font bon ménage, si l’on peut dire, dans "Abena", le nouveau roman de Pierre Chavagné. La montagne y devient à la fois refuge et huis clos sous tension, paysage-personnage qui révèle les failles et les ressources de ceux qui y survivent. Roman de l’attente plus que de l’intrigue, il assemble des figures marginales pour mieux interroger les questions de migration, d’humanité et de vivre-ensemble à travers les gestes, les silences et les voix plutôt qu’à coups de thèses et de vacarme. Porté par un style ciselé, "Abena" appartient aux romans hybrides et puissants, où l’humanité se dispute à la beauté littéraire.

Dans « Abena », la montagne est autant un refuge qu’un espace de danger extrême. Pratiquez-vous la montagne pour en appréhender les paradoxes ? Ce cadre a-t-il une influence particulière sur vos personnages et leur évolution ?
De manière générale, la Nature n’est ni bonne ni mauvaise. Elle ne juge pas, ne se mêle pas de morale, elle laisse cela aux hommes. La Nature vit et ne se préoccupe que de ce qui advient, c’est pourquoi, ce roman est écrit au présent, pour être au plus près des éléments et de l’action. Tout le début du récit est construit ainsi, c’est la topographie, la neige, le vent qui dicte le tempo et les péripéties. Le lecteur est en immersion, il s’essouffle, grelotte, s’inquiète. La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière qui interagit avec les autres protagonistes et les met en lumière. C’est cela le Nature Writing, une littérature des grands espaces, un révélateur d’âmes. En ce qui concerne mes connaissances pratiques : je connais la marche, le bivouac, mais j’ignore tout de la haute montagne et de la neige. Le rythme et le vocabulaire choisit font illusion, c’est la magie du roman. Je me documente, j’imagine, je réfléchis, je ressens, cela me permet de rendre un tableau réaliste. J’évite les termes trop techniques qui ralentissent la lecture et je m’applique à construire du vrai. C’est une mécanique dans laquelle je privilégie le style avant tout ; un bon roman, c’est le souvenir d’une émotion.Ce livre est dédié à Cormac McCarthy. Pour lui, l’Homme malgré le progrès et la science demeure minuscule et provisoire dans une Nature grandiose, presque biblique. Chez lui, le récit se dissout dans le paysage. C’est ce que j’ai essayé de reproduire.
Vos personnages sont très marqués, il y a le marginal, la jeune fille mutique, le couple d’ermites, la milice… Comment avez-vous construit cette galerie humaine pour qu’elle devienne un microcosme symbolique mais non caricatural ?
Oui, il y a aussi le légionnaire déserteur. J’avais besoin de ces personnages marginaux et inadaptés pour mon récit. Abena est avant tout l’histoire d’un malentendu – « mal entendu ». Il y a un autiste léger, une mutique, un vrai muet, une taiseuse, deux étrangers dont un ne parle pas français. Ils sont tous d’âge et d’éducations différentes. Ce groupe va se constituer et résister malgré l’hiver et la folie du monde, par leur envie de survivre et par quelque chose de plus grand qui les dépasse : leur humanité. Je ne caricature jamais mes personnages, car j’essaie de les comprendre et de leur donner un souffle. On ne connait leurs véritables pensées qu’à travers leurs gestes (c’est Hemingway qui m’a appris ça). Les caractères se révèlent peu à peu en se frottant aux autres. Le lecteur avance à tâtons, il a peu d’information et parfois peut se méprendre sur tel ou tel, quand il finit par comprendre, une émotion et un attachement surgit : le personnage existe. De plus, ma façon même de composer un roman donne la part belle aux personnages. Il y a des romans à intrigue et des romans à histoire. Je suis de la seconde école. Je ne fais pas de plan. J’écris le début - quelques pages -, je cherche l’angle de narration et le ton juste, puis j’écris le dernier paragraphe. J’ai les deux berges de mon histoire et ce sont les réactions de mes personnages qui vont me conduire vers le dénouement. Je ne force jamais un personnage à agir contre-nature, tout doit être crédible et fluide. Parfois, il se contredisent, mais cela fait partie intégrante du genre humain. Je veux que mon histoire paraisse évidente - condition sine qua non de l’émotion. Le point faible de cette méthode est le risque d’enlisement narratif. Il faut user de subterfuges pour maintenir de concert le rythme et la vraisemblance.
Le roman mêle suspens narratif, nature writing et méditation humaine. Comment travaillez-vous l’équilibre entre ces dimensions ?
Tout commence par un style qui correspond à l’histoire racontée. (Point de vue, temps, niveau de langue, longueur des phrases, choix des métaphores, choix des adjectifs…) Ce style qui est ma voix, je le fais évoluer à chaque roman. Ce n’est pas artificiel : on ne parle pas de la même manière au travail, dans un vestiaire de rugby ou quand on lit un conte à son enfant. On module ses effets pour obtenir une réaction. Dans Auteur Academy (Grasset) j’avais développé un style corseté, pince sans rire, très années 50, pour créer des effets comiques, dans La Femme paradis (Le mot et le reste), mes phrases étaient sèches, dépouillées, presque à l’os. Dans Les duellistes (Albin Michel), j’employais des phrases longues, construites à la mode du XVIIe siècle, avec des subjonctifs imparfaits et de belles épithètes. Ces phrases seraient incongrues dans Abena. Le style c’est le socle sur lequel tout va reposer. Pour un roman, je peux avoir la meilleure idée du monde, si je ne trouve pas le ton et le bon dispositif narratif, j’abandonne. Abena est un roman dense dans lequel il se passe relativement peu de choses. C’est un roman de l’attente comme Le rivage des Syrtes de Gracq ou Le désert des tartares de Buzzati. Selon moi, le suspense - je préfère parler de tension narrative – réside dans les creux que je laisse volontairement. Le lecteur en souhaitant les combler, entre plus profondément dans l’histoire. N’étant pas asservi par une intrigue, je peux le surprendre voire le sidérer par des réactions ou des événements, auxquels ils ne s’attendaient pas. L’histoire n’est pas formatée, le lecteur est sans repère. C’est moi qui dicte le rythme. Par exemple, la position surélevée de la montagne permet de voir loin, cependant il n’y a rien à voir. Et cette absence d’activité dans la vallée créé une angoisse et un ressort dramatique. La Montagne symbole de liberté devient chez moi, un lieu oppressant, un huis clos à ciel ouvert. Le Nature writing est là, au centre de tout, il fait partie intégrante de l’histoire. Elle oblige les hommes et les femmes à se poser les questions existentielles. Et il y en a beaucoup… Cependant, on ne peut pas tout mettre car le livre deviendrait protéiforme voire difforme. Cela demande beaucoup de réglages, d’ajustements et de réécriture. Pour Abena, j’ai 200 pages de coupes.
Vous abordez la question des migrants de manière concrète et subtile à la fois, en abordant la question par le biais des personnages et de leurs paroles. Comment avez-vous ciselé ce propos pour qu’il demeure une trame de fond ?
D’abord le choix des mots, je n’aime pas essentialiser et ranger les gens dans des cases. Je m’applique à considérer leurs actes et leurs qualités J’emploie une seule fois le mot « migrant » et il ne désigne ni Kofi, ni Abena. Je me suis appliqué à les présenter comme un frère et une sœur, comme un athlète de haut niveau, comme une petite fille intelligente, si intelligente qu’elle va devenir la clef de voute de la communauté et le titre du roman. Et puis, j’alterne les points de vue, en tentant de comprendre chaque interlocuteur, même ceux de la milice : l’angoisse de Karl, la bêtise de Paul, la colère de Déborah…
La figure d’Abena incarne l’avenir dans un monde instable et violent. Comment avez-vous construit ce personnage pour en faire un symbole universel sans tomber dans l’explicite ?
Au début du roman, Abena est sans voix et très effacée. Elle est construite tout en creux et n’existe qu’à travers le regard des autres. On peine à lui donner un âge. Elle représente l’innocence et sa seule présence muette devient le catalyseur du groupe. Au fur et à mesure du récit et des épreuves, son caractère s’affirme, son âge se clarifie, elle devient active, jusqu’à incarner le personnage central et l’horizon de mon histoire. C’est le principe de la mue.
Vous accordez une grande importance au silence et aux non-dits. Cette dimension est-elle centrale dans la mise en tension des relations humaines à travers votre roman ?
Notre monde est bruyant, il confond conversation et bavardage. Les gens sont en recherche de vérité, ce devrait être génial, mais ils finissent par se dresser les uns contre les autres. Ils ne s’écoutent pas ; des camps se forment et se radicalisent, passent d’une indignation à une autre. Tout devient crise et schisme. Il faut choisir haut, bas, gauche, droite. A parler vite, fort, tout le temps, ils interdisent la nuance, la subtilité, la pondération… Pardon par avance aux militants de tous bords, mais la décantation de l’émotion est un préambule à toute pensée et malgré la pertinence de vos causes, je n’entends qu’une cacophonie. Il y a longtemps, j’ai choisi de faire un pas de côté. Un peu comme Jünger, (Le recours aux forêts, Le traité du rebelle, tout ça). Je plante des arbres, j’écoute, j’observe, je ne donne pas de leçon. Je n’ai pas abdiqué, je m’intéresse sans participer. Aucune loi, ni morale ne m’y oblige, même si beaucoup affirment le contraire. Bref, je ne veux persuader ni convaincre personne. Je raconte des histoires et je laisse les gens y réfléchir. Alors, forcément dans Abena cet état d’esprit se ressent. Chaque mot y est pesé, ceux qui sont dit et ceux qui sont tus. J’y mêle de la gêne, du respect, de la peur, parfois de l’humour… Les phrases prononcées sont crédibles et les silences éloquents. Le rythme des conversations ajoute de la profondeur aux mots. Chacun invente son moyen de communication : Pavel utilise un jeu d’échec pour interagir avec Abena ; Caïn, un manuel scolaire ; Kofi, des sourires ; la Vieille, des histoires au coin du feu… Le dénominateur commun entre toutes ces méthodes, c’est le temps long. Réfléchir, partager se connaître, s’apprivoiser demandent de la patience. Nos sociétés, si elles veulent survivre, ne devraient pas l’oublier.
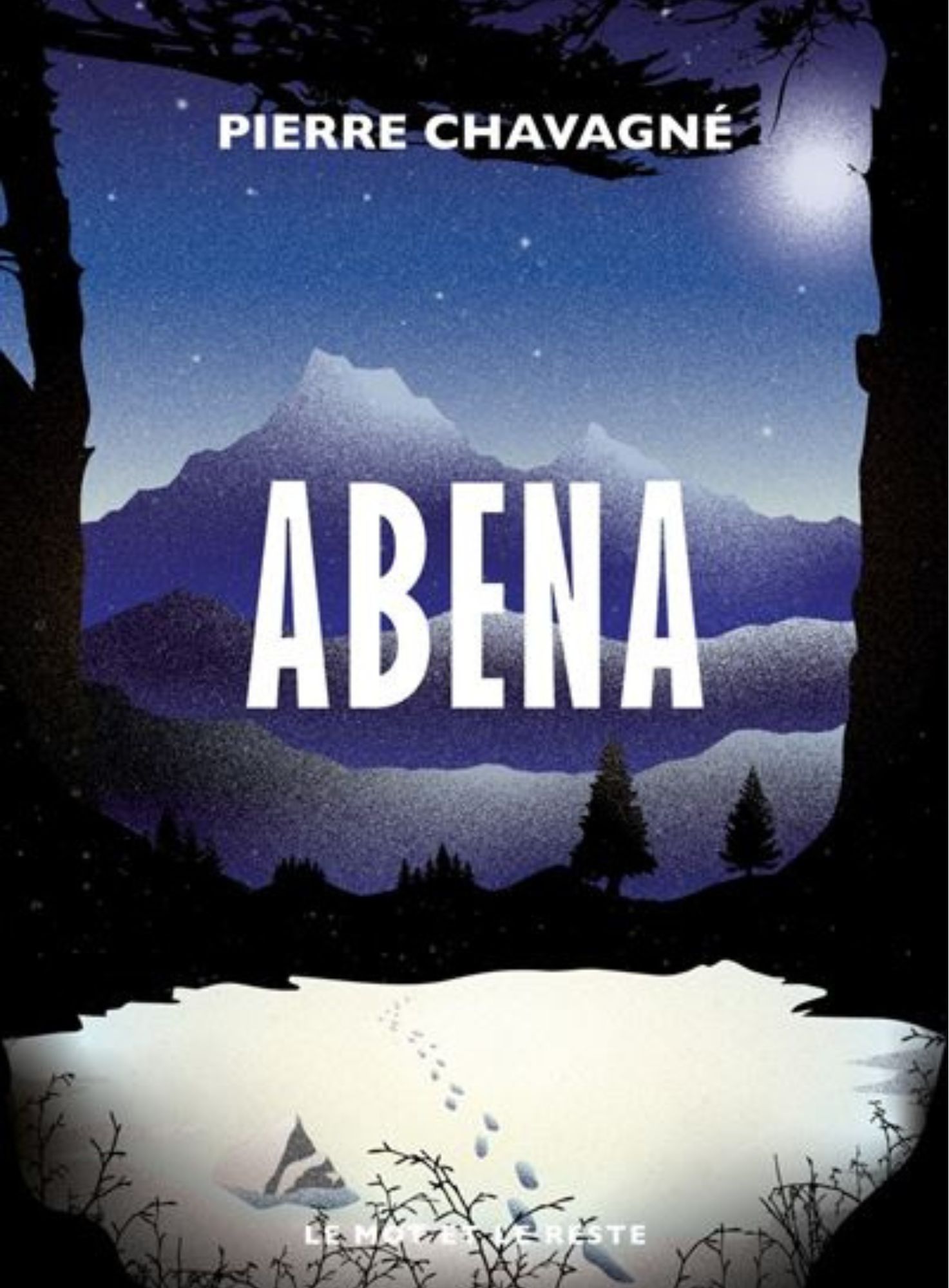
![[INTERVIEW] Pierre Chavagné : "La Nature dans mon roman devient un personnage à part entière"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6938013865c7fbebfa2c0654_abena-pierre-chavagne-lemotetlereste.jpg)
![[INTERVIEW] Laura Lutard : " Soudain, le poème est impératif !"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6932f7ad65a3c836e0d2d5dd_laura-lutard-nee-tissee.jpg)

![[INTERVIEW] Justine Arnal : "Mes phrases sont habitées par plusieurs états du moi en train d’écrire"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6900a0ae0710aa8072b90a69_reve-pomme-acide-quidam.jpg)