La parution d'un bien étrange gros livre croate par les éditions du Sonneur ("La sorcière à la jambe d’os", de Želimir Periš) donne une occasion en or de plonger dans les coulisses du métier traductrice, avec une virtuose en la matière : Chloé Billon.
Quel étrange et prenant texte ! Fresque médiévale sombre et intense, lecture transgénérationnelle des conséquences de la violence masculine, ode à la nature et bien plus encore, "Trois fois la colère" dépasse avec virtuosité les angles stylistiques et les genres romanesques. En posant un décor médiéval cohérent, à la lisière du merveilleux ou fantastique, Laurine Roux évolue avec aisance dans des thématiques très contemporaines où la vengeance, la haine, l’amour et l’espérance avancent côte à côte. Avec une narration maîtrisée, fluide, et des personnages parfaitement campés jusque dans leurs paradoxes, Laurine Roux laisse exploser une langue sensorielle, où poésie et âpreté alternent sans jamais s’effacer. Tout en nuances et en contrastes, ce roman n’oublie pas de célébrer la nature comme, presque, un personnage à part entière. Peut-être pourrions-nous parler de "fresque féministe", de "roman d’émancipation", et autres qualificatifs bien précis. Peut-être pourrions-nous simplement parler d’un grand roman. Echange en subtilité et profondeur avec Laurine Roux.

On dit souvent, par abus de langage, que nous ne sommes « pas au moyen-âge ». Cependant, en dehors des idées reçues et souvent erronées que l’on a sur cette période, la violence, spécifiquement envers les femmes, n’est-elle pas toujours de la même nature ?
Pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge, je me suis documentée, bien sûr, mais j’ai surtout fait très attention à ne pas figer l’époque médiévale en une sorte de cliché. En ce qui concerne plus précisément l’histoire et le statut des femmes en ces temps-là, ils ont été très longtemps méconnus, pour une raison simple : seuls les clercs étaient en mesure d’écrire et de transmettre les savoirs – or ils ne s’intéressaient pas aux « filles d’Ève », marquées par la faute originelle et de facto considérées comme inférieure. La manière de nommer le fragilitas sexus, ou l’infirmitas sexus parle d’elle-même… Cette invisibilisation s’est poursuivie car les médiévistes étaient, jusqu’à il y a peu, majoritairement des hommes, pas forcément pressés de braquer les projecteurs sur l’histoire du deuxième sexe. L’étude des femmes au Moyen-Âge se révèle donc assez récente, et dresse un tableau frappant : l’asymétrie des genres règne à tous les étages. Au sein du couple, où le mari a le droit de battre son épouse, dans l’accès à l’éducation, l’organisation de la société – tant au niveau politique que juridique. La domination masculine est clairement institutionnalisée. Pour revenir à votre question de départ, on peut se réjouir que la société ait évolué, que le statut des femmes ait progressé, mais, in fine, la domination masculine perdure, et se révèle de même nature, générant des violences tout aussi systémiques. Ceci étant, un examen plus fin bouscule certaines idées reçues. Au Moyen-Âge, il existait des femmes au destin plus heureux, qui parvenaient à déjouer les déterminismes. Des seigneuresses régentaient des châteaux, des princesses régissaient, des autrices écrivaient, et les fabliaux de l’époque ont usé jusqu’à la corde la figure du mari ridiculisé par son épouse bien plus futée que lui. J’y lis volontiers une métaphore du pouvoir que d’aucunes réussissaient à endosser. Dans ce sens, j’ai imaginé le personnage de Reine, stratège, ambitieuse, impérieuse. Qui demeure néanmoins victime de la domination paternelle puisque l’ombre d’Hugon régira jusqu’à sa manière d’élever sa fille.
Votre roman mêle un vocabulaire médiéval à des expressions actuelles. Quelle est la dimension politique ou symbolique derrière ce patchwork linguistique ?
J’ai coutume de considérer le roman comme un genre généreux, suffisamment souple pour accueillir des libertés, des frottements langagiers. Ici, j’ai fait très attention à ne pas en rajouter des louches sur le côté Messire, damoiselle et damoiseau, qui peut vite virer au pastiche de l’époque. Hormis quelques touches de vocabulaire ancien ou technique, je désirais que le texte renvoie davantage à l’aujourd’hui qu’à l’hier. Je n’avais pas l’intention d’écrire un roman historique. Bien au contraire, le Moyen-Âge fonctionne plutôt comme un miroir, renvoie à nos dysfonctionnements actuels par une sorte d’effet loupe. De fait, il me paraissait naturel de jouer sur les frictions avec des expressions plus modernes, sans que ce soit choquant. Et puis j’aime le mélange des langues, l’hybridation, derrière lesquels on peut deviner un goût politique pour le métissage, la porosité des frontières, les échanges, traduit ici dans la chair de la langue. Dans mes romans, je fais volontiers entrer des bouts de phrase en espagnol, italien, anglais... D’une certaine manière, l’ancien français sonne aujourd’hui comme une langue lointaine, il a ce charme « exotique ».
La nature y apparaît presque comme un personnage autonome, à la fois refuge et force de révolte. Comment concevez-vous son rôle dans le récit et dans la dynamique des personnages ?
Dans la galerie de mes personnages, il en est que je qualifie de personnages-cabanes : ceux que j’aime, comme Joseph, Gala, Éphraïm, Pietro, Guillaume ou Mange-Ciel, auprès desquels je me réfugie et me blottis. Tous entretiennent un lien consubstantiel avec la nature. Leur corps, leurs mouvements, leurs élans se dessinent toujours dans un jeu d’interactions avec les éléments, le paysage, et c’est ainsi qu’ils m’arrivent : façonnés par les lieux. Gala est indissociable de la forêt de Bénévent. D’ailleurs, quand elle s’en éloigne, il lui arrive toujours des bricoles. Comme si elle perdait un organe propre, essentiel. C’est sûrement une des raisons qui impose la nature comme un personnage à part entière, une force. Aussi parce que cela correspond à ma relation personnelle avec les montagnes, les arbres, les cascades... J’ai grandi dans les Hautes-Alpes, plongée dans ce bain primordial, vital. La nature est également force de révolte : menacé par l’homme et ses passions tristes, le vivant en nous, et hors de nous, nous oblige, convoque notre indignation. La violence et la sauvagerie se situent du côté des marchés, du capitalisme, de la fermeture des frontières, de la froideur que le libéralisme impose à nos sociétés. À l’inverse, quand on a fait la paix avec sa propre animalité, comme Pietro et Éphraïm, le sauvage – contrairement à la sauvagerie – ne fait pas peur, il est source de compréhension, de décolonisation du regard, de décentrement. Je vois dans ce biais une façon plus désirable d’habiter le monde, mieux, de cohabiter. Ce ne sont pas Miou et la Noiraude qui diraient le contraire !
Vous explorez trois générations marquées par la violence et la colère, mais aussi la quête de justice. Comment avez-vous pensé la transmission de ces haines et espérances ?
J’aime beaucoup l’idée que vous coupliez la haine et l’espérance, qui marchent côte à côte dans ce roman. Je ne veux pas en dire trop pour éviter de « divulgâcher », mais c’est avant tout un roman pétri d’espoir, même s’il est traversé par beaucoup de noirceur. La colère, la haine, mais aussi l’espoir, tous se transmettent ici de génération en génération. C’est un fait connu de la psychanalyse et de l’épigénétique que les traumatismes, les exils, les guerres se répercutent en avalanche dans les lignées. Cela est passionnant quand on veut construire un personnage ! Chacun hérite du poids de ce(ux) qui précède(nt). Concrètement, j’ai laissé Reine, Éphraïm, Mange-Ciel et Miou me raconter comment ils s’emparaient de cet héritage commun. Je n’ai pas choisi. Certains rompaient avec le passé, parvenaient à s’inventer une identité nouvelle, d’autres choyaient la haine, pour le meilleur et pour le pire. C’était d’autant plus intéressant que les triplés – qui partageaient un même patrimoine génétique – étaient séparés à la naissance. Le roman devenait un laboratoire parfait pour observer comment une famille, un parcours, telle ou telle rencontre peuvent changer le cours d’une vie !
Le roman souligne le conflit entre vengeance et justice naissante. Que vous inspire ce dilemme dans le monde contemporain ?
Une chose est certaine, la question de la justice était à la racine de ce roman. Je suis frappée par les tribunaux médiatiques, par les lynchages sur les réseaux sociaux, comme des résurgences archaïques, des pulsions collectives. La justice, bien qu’imparfaite, est une institution attaquée de toutes parts, menacée, et je crois que ces problèmes me taraudaient tellement, sans que je ne trouve de réponse toute faite, que j’ai eu besoin d’écrire pour mieux comprendre. Modiano disait que par sa sensibilité exacerbée, l’écrivain est une sorte de sismologue, qu’il pressent les secousses d’une société bien avant qu’elles ne parviennent à la surface de la terre. Je veux bien le croire, et quand mes hantises sont trop fortes, elles ne trouvent d’autre voie d’exploration que le roman. Cela m’a fait du bien de revenir aux origines de notre justice, d’en remonter la piste. Et j’avoue être étonnée de voir, après la sortie du roman, les résonances avec l’actualité.
Quelle place accordez-vous à la question du féminin dans cette fresque médiévale, et comment avez-vous imaginé les figures féminines dans cet univers de domination masculine ?
Les figures féminines sont nombreuses et diverses. Hors de question pour moi d’être manichéenne. Il existe de sacrée « garces » (intéressant, ce phénomène sémantique voulant que le féminin de certains noms devienne péjoratif…), dominatrices, manipulatrices, mais celles que j’aime, dans lesquelles je me suis le plus volontiers glissée, se placent toutes sous le « matronage » de Gala, qui s’émancipe des hommes, mais aussi des humains, pour vivre hors de toute domination, au cœur de la forêt, que j’imagine un peu comme un placenta vert. Son corps est animal, sensuel, celui de ses descendantes aussi – je pense à Mange-Ciel, l’idiote céleste, qui n’a aucun filtre, laisse libre cours à sa libido. Je trouve ça important de raconter le/s désir/s féminin/s depuis un corps féminin. Je me rappelle avoir lu un texte écrit par un homme, et souri lorsque son héroïne sent monter en elle, je cite de mémoire, « le désir de son utérus à son nombril ». Autant vous dire qu’aucune femme ne formulerait la chose ainsi ! Le corolaire : déboulonner la figure du héros viril, proposer des personnages masculins doux, comme le sont Éphraïm, Guillaume et Pietro. Ceci étant, mon combat féministe excède la littérature : écrire des romans féministes, saboter le schéma patriarcal des épopées n’apportera malheureusement pas le droit de vote aux femmes afghanes, ne mettra pas un terme aux féminicides, mais je reste persuadée que cela peut contribuer à infléchir les représentations.
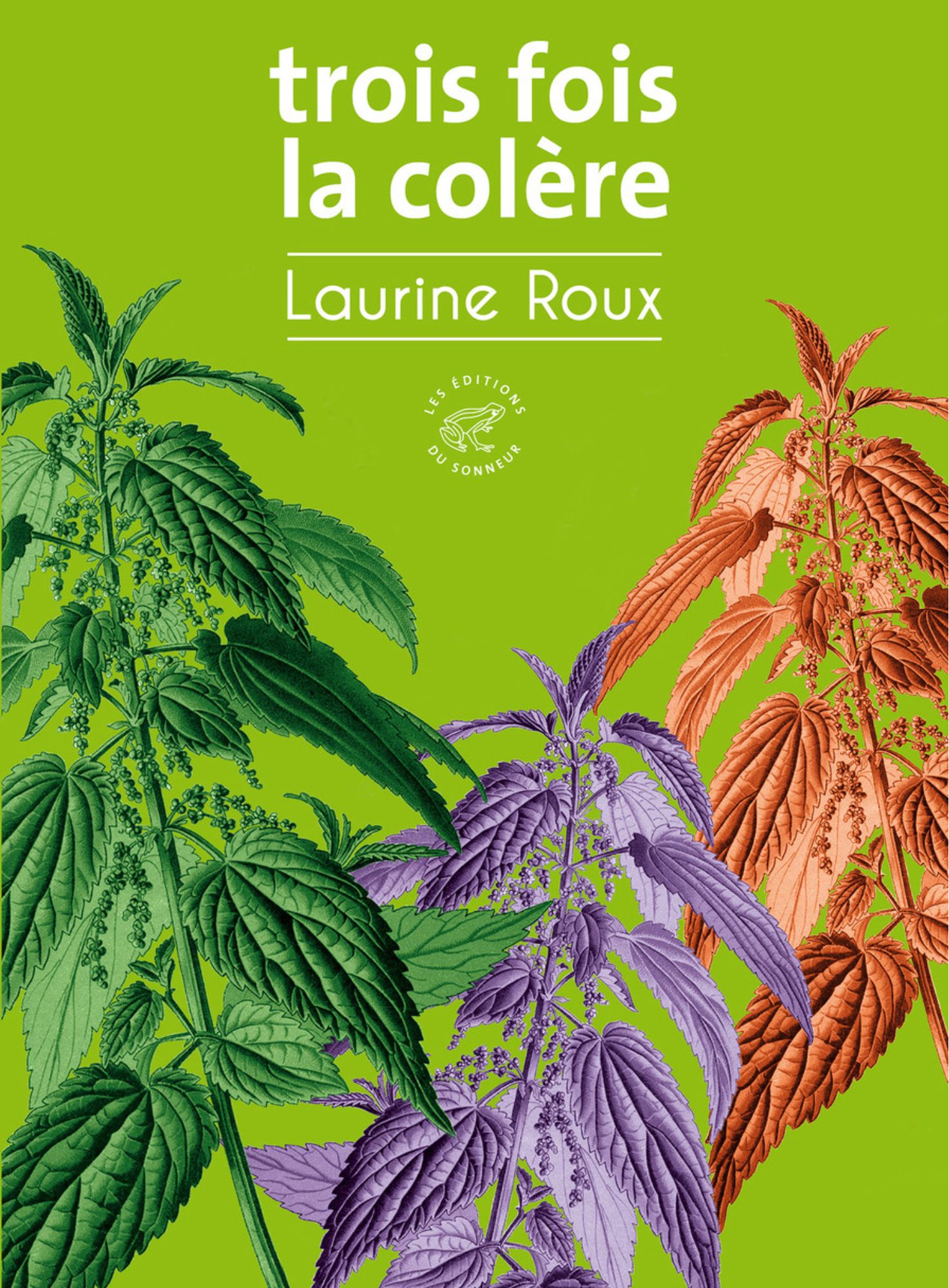
![[INTERVIEW] Laurine Roux : "Le Moyen-Âge renvoie à nos dysfonctionnements actuels par une sorte d’effet loupe"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/69009b37191a726f5746393b_3-fois-cole%CC%80re-laurine-roux.jpg)
![[INTERVIEW] Chloé Billon : " La sensibilité de la personne qui traduit est importante pour toute traduction"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/693302311bcfe270764fb0a5_sorciere-a-la-jambe-dos-sonneur.jpg)
![[INTERVIEW] Les éditions Esquif](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6937eab59fd3801c10974b9e_esquif-edition-independante.jpg)
![[INTERVIEW] Christophe Siébert : "Non Conforme : des textes qui ne sont pas pensés pour plaire à la critique bourgeoise"](https://cdn.prod.website-files.com/63bc3dced6941a828cf893ac/6936b35cc4cdd220a638cf4a_non-conforme-banniere.jpg)